- Association pour les Nations Unies
- Posts
- Bulletin d’information | octobre - novembre 2024
Bulletin d’information | octobre - novembre 2024
Bulletin d'information | octobre - novembre 2024
Chers membres et sympathisant(e)s,
À l'Association pour les Nations Unies (APNU), notre mission est de tisser des liens entre nos membres et les Nations Unies. Grâce à votre soutien, nous continuons à éclairer, inspirer et mobiliser notre communauté sur les enjeux internationaux. Découvrez des articles et des mises à jours essentielles qui promettent d'enrichir votre connaissance des actions des Nations Unies à travers le monde.
Pour tout commentaire ou suggestion, n’hésitez pas à nous contacter ([email protected]).
DANS CETTE ÉDITION…
Quinzaine de la solidarité internationale : Conférence APNU sur la construction de la paix (03/10)
COP16 sur la biodiversité en Colombie (21/10 - 01/11)
SDG Forum 2024 : Atelier UNA Belgium (05/11)
COP29 sur le climat en Azerbaïdjan (11/11 - 23/11)
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25/11) : « Les femmes dans les conflits armés : focus sur la Palestine et l’Ukraine »
Handicap : Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées - rapport UNIA
Population et pauvreté : Rapport d’Olivier de Schutter « L’économie du burn-out »
Conflit Israël - Hamas : La situation de l’UNRWA
Conflit Israël - Hamas : Décisions de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale (22/11)
Conflits oubliés : La situation des Rohingya au Myanmar et au Bangladesh
A LA UNE
Quinzaine de la solidarité internationale - Conférence APNU (03/10)
La construction de la paix : le rôle de l’ONU, ses défis actuels

Que peut-on retenir de cette conférence organisée par l’APNU dans le cadre de la Quinzaine de la solidarité internationale de la ville de Bruxelles ? Beaucoup d’intérêt pour la thématique retenue, beaucoup d’inquiétudes également, mais une conclusion optimiste : la Charte des Nations Unies n’est pas démodée, elle reste le cadre et la “boussole” des relations entre Etats. Dans les moments de crise, c’est un texte de référence, qui démontre sa pertinence.
Au cours d’un échange d’une heure, le représentant du bureau de liaison ONU à Bruxelles pour la paix et la sécurité (UNLOPS) et une experte des opérations de maintien de la paix ont expliqué au public le rôle de l'ONU et les défis auxquels elle est confrontée dans ce domaine.
Introduction
L’Organisation des Nations Unies a été fondée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale, dans le but de préserver la paix et la sécurité internationale. Cet objectif, qui fonde la Charte, est aujourd’hui encore au cœur de son action.
L’ONU joue un rôle essentiel dans les processus de construction de la paix, en déployant des missions de maintien de la paix, en soutenant les négociations entre parties belligérantes et en renforçant les institutions locales pour éviter une reprise des hostilités.
Construire la paix : Prévention des conflits et maintien de la paix
Éviter que des conflits ne se déclenchent ou ne s’embrasent à nouveau constitue une priorité pour l’ONU. La diplomatie préventive et les opérations de maintien de la paix des Nations Unies (OMP) sont désormais les modes privilégiés de ses interventions pour apaiser les conflits et limiter leurs effets les plus néfastes. Elles visent à créer les conditions favorables à la sauvegarde ou à un retour à la paix. Les OMP œuvrent à fois à la protection des civils et de distribution de l’aide humanitaire, au respect des droits humains, et au maintien de la sécurité dans un contexte de crise. Leur composante politique a pour tâche notamment d’amener les parties à renoncer aux armes et à contribuer à mettre sur pied des institutions durables.
Depuis sa création, l’ONU a déployé 72 missions, dont 12 sont toujours en cours aujourd’hui. Leur efficacité varie selon les contextes et les mandats spécifiques, avec des résultats parfois mitigés. Dans certaines situations, les forces de l’ONU ont contribué de manière significative à la réduction des violences, à la protection des civils et à la stabilisation des zones de conflit, comme au Liberia, en Sierra Leone ou au Cambodge, où leurs interventions ont débouché sur des processus de paix durables. Mais on compte aussi des échecs : au Rwanda ou à Srebrenica, les soldats de l’ONU n’ont pas été en mesure de protéger les civils ni d’empêcher des génocides, faute d’un mandat adéquat ou d’une interprétation trop restrictive de celui-ci.
Les défis
Il existe aussi des défis persistants qui peuvent limiter l’efficacité de ces missions. Parmi ceux-ci : des financements insuffisants, des mandats inadaptés, le manque d’équipements et de formation des troupes déployées sur le terrain, une coopération difficile avec les acteurs locaux et les parties au conflit, mais aussi un manque de soutien politique de la part des Etats membres. L’ONU tente d’améliorer ses opérations en renforçant la formation, en modernisant les mandats et leur mise en oeuvre et en augmentant la transparence, mais leur succès dépend aussi de la bonne volonté de leurs interlocuteurs sur le terrain et du soutien de la communauté internationale.
Les conflits auxquels est confrontée l'ONU sont par ailleurs multiples et d’une complexité croissante. Ils impliquent de plus en plus souvent des acteurs non étatiques, peu soucieux du respect du droit international. Le terrorisme et le crime organisé créent sur le terrain des dynamiques complexes, qui rendent les interventions plus difficiles. En outre, les réformes nécessaires à la pérennisation de la paix se heurtent souvent aux intérêts bien ancrés de certaines des parties ou de gouvernements faibles ou corrompus.
En conclusion
Malgré ces obstacles, les Nations Unies continuent de chercher des solutions novatrices, qui mettent davantage l’accent sur la prévention des conflits et tiennent compte des contextes locaux spécifiques à chaque mission. Le Pacte pour l’Avenir adopté en septembre 2024 à New York consacre un chapitre important à ces questions et les améliorations devront se poursuivre .
Cependant, le niveau d’attente est parfois démesuré vis-à-vis des capacités de l’ONU à mettre fin à la guerre et à construire la paix. L’ONU ne travaille pas en vase clos. En matière de paix et de sécurité, ses Etats membres adoptent des décisions qui ont un caractère obligatoire. Ces Etats ont donc une responsabilité cruciale en matière de suivi et d’exécution efficace de celles-ci.
Christine Van Nieuwenhuyse, Vice-présidente APNU
La 16e Conférence des Parties sur la Biodiversité à Cali (Colombie)
21 octobre - 1er novembre 2024

UNDP
Du 21 octobre au 1er novembre 2024, les représentants de haut niveau de 196 pays, ainsi que des représentants de la société civile (y compris des peuples autochtones) et des secteurs économiques, se sont réunis à Cali (Colombie) pour la 16e Conférence des Parties (COP) à la Convention des Nations Unies sur la biodiversité de 1992. L’ONU joue un rôle important dans la préparation, la coordination, le bon déroulement et la communication relative à ces COP.
Le but de la Conférence était de progresser dans la mise en œuvre des mesures de protection de la planète, au vu des pertes persistantes d’espèce végétales et animales et des menaces de destruction qui pèsent sur des écosystèmes mondiaux. La 15e COP avait, rappelons-le, débouché sur des engagements importants, avec l’adoption du Kunming-Montreal Biodiversity Framework sur la protection de la nature, la restauration des écosystèmes dégradés, le démantèlement des subsides pour certaines activités polluantes de l’agriculture et de l’industrie et la promesse d’une aide financière de 20 milliards de dollars US en faveur des pays les plus pauvres dès 2025, pour parvenir à 200 milliards à partir de 2030, destinée à la mise en œuvre d’actions de protection de la biodiversité.
Les enjeux restent considérables ; bien au-delà du risque d’extinction de certaines espèces, c’est l’équilibre même des écosystèmes qui se trouve menacé, et en conséquence, la qualité de nos produits alimentaires, celle de l’eau que nous buvons, et celle de l’air que nous respirons. La plupart des problèmes sont le résultat d’activités humaines et nombre d’entre eux sont liés à une autre problématique importante, celle du changement climatique.
Pourtant le résultat de cette nouvelle COP, surtout au regard des progrès engrangés lors de la précédente édition, est jugé décevant.
Au chapitre des avancées on peut relever :
La création d’un fonds spécifique, dit Fonds Cali, pour que le matériel génétique animal et végétal profite de manière équitable à l’ensemble de l’humanité, à financer via une partie des bénéfices des entreprises qui exploitent commercialement ces ressources
La création d’un organe dédié chargé de représenter les intérêts des populations autochtones qui jouent un rôle important de protection de la nature et de la biodiversité
L’adoption d’un plan biodiversité-santé
Des engagements sur le renforcement des synergies avec la Convention cadre sur le climat
Les pays en développement espéraient pour leur part la création d’un nouveau Fonds multilatéral dédié à la Biodiversité, les montants versés jusqu’à présent via la Global Environment Facility demeurant largement sous les montants envisagés à Montréal; mais un accord à ce sujet n’a pas pu se dégager en raison des réticences des pays développés, qui disent vouloir éviter la création d’un nouvel instrument mais aussi s’interrogent sur la meilleure manière de mobiliser les financements nécessaires, au-delà des contributions des Etats.
La mise en œuvre des engagements non-financiers pris à la COP15 tarde elle aussi à se matérialiser, y compris l’élaboration ou la mise à jour de Plans Nationaux de Biodiversité, qui doivent guider les Etats dans la mise en œuvre des décisions des COP, notamment l’identification des zones à protéger ou à réhabiliter. Plus de 150 pays sont en retard. Et seuls 36 pays ont déjà élaboré un plan de diminution des subventions aux activités industrielles et agricoles polluantes.
Aucun Ministre belge n’était présent à la COP de Cali. La Belgique n’a pas non plus présenté sa stratégie nationale Biodiversité, toujours soumise à révision au niveau national. Toutefois elle a rejoint le nouveau Groupe des Champions (Mainstreaming Champions Group), qui a pour objectif de renforcer l’intégration dans tous les secteurs de l’économie mondiale des objectifs et des principes du Cadre Mondial pour la Biodiversité.
Quelques semaines après l’adoption par l’Assemblée du Pacte de l’Avenir, sur le renforcement du multilatéralisme et des Nations Unies, et en dépit des efforts louables du pays hôte, on peut regretter que l’occasion de renforcer l’image de la coopération internationale n’ait pas été saisie à Cali.
Geert Deserranno, administrateurAPNU
SDG Forum 2024 - Atelier UNA Belgium (05/11)
« The road to 2030: after the Pact of the Future, what perspectives for the SDGs? »
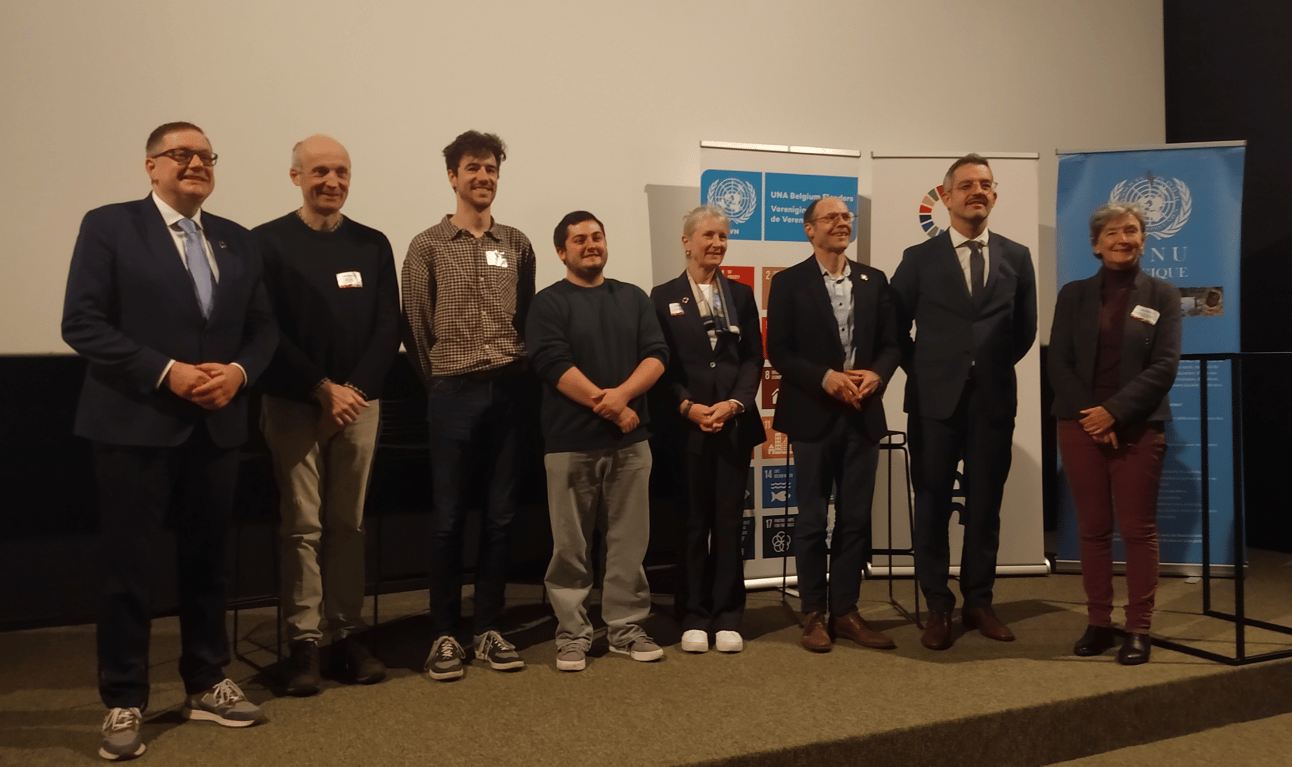
Le SDG Forum est organisé par une vingtaine de partenaires de tous les horizons du secteur du développement durable. Il a eu lieu cette année les 5 et 6 novembre 2024 à Flagey. Le Forum donne aux décideurs politiques, aux entreprises, aux ONG et aux universités la possibilité de se rencontrer et d’échanger des idées et des solutions sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD).
A cette occasion, l’UNA-Belgium (qui réunit l’APNU et son homologue flamande, la VVN) a tenu un atelier consacré aux perspectives de mise en œuvre des ODD après l’adoption du Pacte pour l’avenir par les chefs d’État et de Gouvernement à l’ONU, en septembre dernier, dans le cadre du Sommet de l’avenir. Les débats ont eu lieu en anglais.
Devant une salle pleine, sous la modération de Peter Wollaert, Président de la VVN, le sujet a été traité par Camilla Brückner, Directrice du Bureau de l’ONU à Bruxelles, Olivier De Schutter, Professeur à l’UCL et Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’Homme et l’extrême pauvreté, Jan Mertens du Conseil Fédéral du développement durable, Wim Schaerlaekens du Service public fédéral des affaires étrangères et deux représentants des jeunes, Sean Nart du Forum de la jeunesse et Wouter Radeur du Vlaamse Jeugdraad, qui ont tous deux participé au Sommet à New York.
Dans son introduction, Peter Wollaert, a d’abord rappelé le fondement même l’Organisation des Nations Unies, comme défini dans le préambule de sa Charte de 1945. Il a indiqué que, selon le dernier rapport sur l’état des ODD, le monde reste loin de pouvoir les atteindre pour 2030. Seulement 17 % des cibles des ODD sont à ce jour sur la bonne voie, alors que près de la moitié affichent des progrès minimes ou modérés et que plus d’un tiers sont au point mort, voir en régression. Une bonne nouvelle cependant: l’adoption par consensus du Pacte pour l’avenir, par lequel tous les Etats reconfirment notamment leur engagement à faire tous les efforts nécessaires pour tenter d’atteindre les ODD. Deux documents ont été annexés à ce Pacte: le Pacte numérique mondial définit des principes partagés pour un avenir numérique ouvert, libre et sécurisé pour tous, tandis que la Déclaration sur les générations futures est source d’espoir pour la jeunesse.
Camilla Brückner a reconnu que les progrès dans la réalisation des ODD se sont interrompus suite à la crise du Covid 19 et qu’on assiste depuis plusieurs années à une aggravation des tensions et à la perte de confiance envers les institutions internationales. Malgré cela, d’intenses consultations à tous les niveaux ont conduit à l’adoption du Pacte et à la reconnaissance de la nécessité absolue de redoubler d’efforts en particulier pour le climat et la paix et pour tenter d’atteindre l’ensemble des ODD d’ici 2030. Il a aussi été reconnu que le niveau du financement reste largement insuffisant: 60 pays sont en profonde difficulté financière, consacrent une importante partie de leurs revenus au remboursement de leur dette et ont besoin d’une aide urgente. Les États ont du reste reconnu la nécessité de transformer les mécanismes de la gouvernance mondiale, notamment de revoir la structure et le fonctionnement des institutions financières internationales et du Conseil de sécurité. Tout cela devrait conduire à plus de coopération internationale, mais la responsabilité de la mise en œuvre revient aux États membres. Le système des Nations Unies a pour sa part mis en place des équipes de soutien dans de très nombreux pays et un mécanisme de suivi et de réunions régulières permettra d’examiner les progrès.
Olivier De Schutter a reconnu que l’adoption du Pacte était un accomplissement majeur dans le contexte international actuel. Il comporte en effet des avancées prometteuses dans plusieurs domaines: d’abord dans le financement d’une meilleure protection sociale et la réduction de la pauvreté en changeant d’approche vers des marchés plus inclusifs et même en préconisant des actions en amont des marchés en faveur des jeunes, ensuite dans la protection des droits humains avec un meilleur accès à la justice et une approche où la protection des droits humains ne serait plus le résultat du développement mais un moyen de l’assurer, et enfin dans la gouvernance des mécanismes de financement avec des mesures essentielles d’allègement de la dette. Il a rappelé à cet égard que 3,3 milliards de personnes vivent dans des pays qui consacrent plus de budget au service de la dette qu’à la santé ou à l’éducation et que les propositions pour y remédier n’ont pas été suffisamment mises en œuvre.
Le professeur De Schutter a aussi émis deux critiques importantes quant au contenu du Pacte. D’abord, il existe toujours une dichotomie préjudiciable entre les politiques promues par le système des Nations Unies et celles poursuivies par les institutions financières internationales et l’OMC. Ensuite, l’approche préconisée pour les pays en développement de fonder leur croissance sur les exportations n’est pas appropriée car ceci se fait au dépend de leur accès à leurs propres ressources naturelles. Sans préconiser l’autarcie, il faut que le commerce mondial, qui reste un moteur de développement, soit régulé par des mesures plus justes. Il faut aussi abandonner l’idée que la croissance à tout prix permettra d’éradiquer la pauvreté.
Dans le débat qui a suivi, Wim Schaerlaekens a confirmé que pour la Belgique, le multilatéralisme reste essentiel pour faire face aux défis mondiaux. Dans ce contexte, le Pacte pour l’avenir est certainement bienvenu. Il a regretté toutefois qu’il ne soit pas suffisamment « transformateur ». Le Sud global devrait être mieux entendu et écouté : les ODD sont une bonne base pour le dialogue que les pays développés devraient entretenir avec les pays du Sud, tout en faisant bien davantage leur part vers le changement.
Jan Mertens, tout en reconnaissant que l’adoption du Pacte est une avancée majeure dans le contexte international actuel, a estimé que la réaction des États n’est pas à la hauteur de l’urgence et de l’intensité requise pour faire face aux défis mondiaux. Il a aussi regretté le manque de transparence des États qui, tout en appuyant le principe des ODD, ne prennent pas les mesures nécessaires pour leur mise en œuvre.
Sean Nart a indiqué que pour lui, le Pacte était un document fort, mais s’est interrogé sur la volonté de le mettre en œuvre. Il a aussi regretté que la participation des jeunes n’ait pas été suffisamment facilitée et que l’impact de leur consultation reste limité.
Wouter Radeur a aussi regretté que les représentants de la jeunesse n'aient pas eu accès aux négociations, car ils auraient voulu pouvoir être plus impliqués. Par exemple, la Déclaration sur les générations futures ne fait pratiquement pas référence à la protection des droits de l’enfant. Il est vrai aussi que les représentants de la jeunesse n’avaient pas la capacité de couvrir tous les sujets et qu’à l’avenir, ils devraient assurer une meilleure coordination pour mieux faire part de leurs préoccupations.
L’atelier s’est clôturé par une série de questions/réponses portant notamment sur la nécessité de mieux impliquer les organisations de la société civile dans les négociations et surtout sur la question du financement, en particulier du Fonds pour la protection sociale. Le financement devient une pierre d’achoppement régulière dans les négociations multilatérales comme l’indiquent les résultats de la récente COP 16 sur la biodiversité. Il sera au centre des débats lors de la COP 29 sur le climat. A cet égard, Jan Mertens a relevé qu’il s’agissait en fait d’une question de justice intergénérationnelle: les pays industrialisés doivent reconnaître leur responsabilité dans la situation actuelle, accepter de payer leur dû et changer leur comportement.
André Hupin, Secrétaire général APNU
La 29e Conférence des Parties sur le Climat à Bakou (Azerbaïdjan)
Accord à minima

Après prolongation, la 29e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur le Climat à Bakou, sous présidence azerbaïdjanaise, s’est finalement clôturée le 23 novembre.
Les négociations compliquées ont longtemps achoppé sur le montant des financements que les pays développés, principaux émetteurs historiques, étaient disposés à accorder aux pays en développement pour les aider à réaliser leur transition énergétique et leur adaptation au changement climatique.
Les discussions semblent s’être déroulées sur fond de méfiance réciproque et de remise en question par certains États des acquis de la COP 28 sur la sortie progressive des énergies fossiles. L’examen des ambitions climatiques, révisées à la hausse, de chaque État (Nationally Determined Contribution) semble avoir finalement été repoussé à la prochaine COP.
In extremis, un accord est intervenu qui fixe à 300 milliards de dollars US par an d’ici à 2035 les financements officiels aux pays en développement. Vu l’ampleur des défis auxquels ceux-ci sont confrontés, ce montant est jugé largement insuffisant par les pays récipiendaires et par de nombreuses ONG. Il devrait être complété par des ressources à concurrence 1000 milliards de dollars, issues du secteur privé qu’il faudra mobiliser…
Le déroulement de cette COP soulève à nouveau de nombreuses questions sur la volonté réelle des gouvernements de remplir les engagements de l’accord de Paris, sur l’efficacité relative du format actuel des COP, sur le choix des futures présidences et sur l’influence du secteur des énergies fossiles.
Le prochain Bulletin reviendra sur ce dossier.
Bénédicte Frankinet, administratrice APNU
ARTICLES THÉMATIQUES
Les femmes dans les conflits armés : Focus sur la Palestine et l’Ukraine

Sebastian Backhaus/Agentur Focus/Redux
À l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, le 25 novembre.
En 2023, les conflits en Palestine et en Ukraine ont touché les femmes de façon disproportionnée, soulignant à la fois leur exclusion persistante des processus de paix et la gravité des violations du droit international humanitaire qui pèsent sur elles. Les statistiques publiées par l’ONU sont particulièrement alarmantes : le nombre de femmes tuées dans les conflits armés a doublé par rapport à 2022; elles représentent désormais quatre décès sur dix. De plus, les cas de violences sexuelles liées aux conflits ont augmenté de 50 %.
En Palestine, notamment dans la bande de Gaza, environ 180 femmes accouchent chaque jour dans des conditions critiques, sans accès aux produits de première nécessité ni aux soins médicaux de base. 70% des victimes civiles de cette guerre sont des femmes et des enfants. En Ukraine, des millions de femmes subissent les effets physiques, psychologiques et économiques de la guerre. Ces réalités soulignent que, malgré les protections théoriques du droit international, les femmes en zones de conflit armé sont toujours victimes de violence et de privations disproportionnées, souvent sans recours ni protection adéquate.
L’exclusion des femmes des processus de paix aggrave encore cette situation. Bien que les femmes soient disproportionnellement affectées par les conflits, leurs voix sont régulièrement marginalisées lors des négociations. En Palestine, des groupes de femmes tentent de bâtir des initiatives de dialogue et de stabilité communautaire, mais leurs efforts restent trop souvent ignorés des grands processus diplomatiques. En Ukraine, les femmes jouent également un rôle actif dans la reconstruction et la cohésion sociale, mais elles peinent à intégrer les instances de décision officielles. Cette exclusion est non seulement injuste, mais elle limite aussi l'efficacité des initiatives de paix, car les femmes représentent la moitié de l’humanité et apportent donc des perspectives essentielles sur la sécurité et la réconciliation.
À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, ces constats ne doivent cesser d’alerter la communauté internationale : il est essentiel d’adopter des mesures concrètes pour renforcer la protection des droits des femmes en zones de conflit et pour leur assurer une place active dans la construction de la paix. Ignorer leur voix et les laisser sans protection est un double échec, moral et stratégique, qui contribue à de perpétuer la violence et l'instabilité.
Diane Gardiol, Administratrice APNU
Sources :
ONU Femmes, « Protéger les droits des femmes en période de conflit », UN Women News Stories
ONU Femmes, « Les impacts des conflits armés sur les femmes et les enfants », novembre 2023.
BBC, « Nearly 70% of Gaza war dead are women and children, UN says », novembre 2024.
Convention des Nations-Unies du 13 décembre 2006, relative aux droits des personnes handicapées : Rapport UNIA

Le Mouvement Personne D’abord est une association de personnes présentant une déficience intellectuelle qui militent pour leurs droits, leur auto-représentation et leur auto-détermination. Le 20 septembre 2024, l’association a organisé une journée d’étude inclusive à Verviers autour de la Convention des Nations-Unies du 13 décembre 2006, relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur en Belgique le 1er août 2009. A cette occasion, Carole Van Basselaere a présenté l’excellent rapport d’Unia soumis pour la Belgique le 22 août dernier à Genève au Comité des droits des personnes handicapées, l’organe de contrôle de la Convention. Dans les discussions au Comité, la question de l’accès aux droits a été posée à nouveau, ainsi que celle de la nécessité d’entendre les personnes concernées.
Françoise Tulkens, Présidente APNU
Nouveau rapport d’Olivier de Schutter : « L’économie du burnout »

© Al-emrun Garjon/AP/SIPA
Chaque année, le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté soumet un rapport thématique au Conseil des droits de l’homme de l’ONU en juin, et un second rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies en octobre.
Cette année, Olivier de Schutter a publié un rapport intitulé : « L’économie du burnout »
Les sociétés actuelles sont obsédées par la croissance et une quête «obsessionnelle » de l’augmentation du PIB. Cette quête de la croissance est souvent contre-productive. Non seulement elle a souvent contribué à augmenter les inégalités, mais ce climat de compétition et de course à la performance entraîne un sentiment d’anxiété poussant à la dépression les travailleurs et travailleuses qui ne parviennent pas à répondre à des attentes irréalistes de productivité.
Dans ce rapport, le Rapporteur spécial Olivier De Schutter examine les liens entre pauvreté et troubles mentaux. Il souligne que, malgré leur résilience, les personnes pauvres sont particulièrement vulnérables aux problèmes de santé mentale, qui contribuent à perpétuer la pauvreté. Olivier De Schutter plaide pour un changement d'approche : passer d'un modèle biomédical centré sur l'individu à une vision sociale qui s'attaque aux causes structurelles de la détresse mentale, comme l'inégalité et l'insécurité économique. Il recommande de renforcer la protection sociale, d’instaurer un revenu minimum universel, de déstigmatiser les troubles mentaux et de faciliter l’accès à des espaces verts. Il conclut que le bien-être devrait primer sur la recherche continue de croissance économique.
Conflit Israël - Hamas : la situation de l’UNRWA

Photo ILO
Le 28 octobre 2024, le Parlement israélien a voté à une écrasante majorité en faveur d'un projet de loi interdisant les activités en Israël (y compris Jérusalem-Est) de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Un second texte, également largement adopté (89 contre 7), interdit aux responsables israéliens de travailler avec l'UNRWA et ses employés, ce qui devrait considérablement perturber les activités de l'agence, alors qu'Israël contrôle strictement toutes les entrées de cargaisons d'aide humanitaire vers Gaza.
Ce vote, qui va à l’encontre des obligations de l’État d’Israël en vertu du droit international, a suscité de vives réactions. L’APNU et la VVN, au nom de l’UNA Belgium, ont signé diverses pétitions dénonçant l’acharnement du gouvernement israélien contre les Nations Unies, et particulièrement contre son agence l’UNRWA
L’APNU s’est joint a une lettre de soutien à l’UNRWA, préparée par les professeurs de l’Université Johns-Hopkins, publiée dans The Lancet.
UNA Belgium s’est également jointe à la déclaration conjointe préparée par l’UNA Benelux dénonçant les nombreuses attaques du gouvernement israélien contre les Nations Unies, et ses violations du droit international humanitaire.
Lire : La Belgique regrette profondément les lois anti-UNRWA adoptées aujourd'hui par le parlement israélien (SPF Affaires étrangères)
L’UNRWA, dans une lettre adressée au Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, a aussi exprimé ses craintes à propos de cette décision et dénoncé son caractère illégal par rapport au droit international.
Christine Van Nieuwenhuyse
Conflit Israël - Hamas : Décisions de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale (22/11)

CPI
La Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, d’une part, et du chef militaire du Hamas, Mohammed Deif, d’autre part, sur la base d'allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Les accusations contre Netanyahu et Gallant portent sur des attaques délibérées contre des civils, l'utilisation de la faim comme arme de guerre, des meurtres, persécutions et d’autres actes inhumains. Mohammed Deif est accusé de meurtre, de torture, de viol et de prise d'otages.
- Que dit la Chambre préliminaire[1] ? La Chambre a délivré les mandats d’arrêt demandés par le Procureur de la Cour le 20 mai dernier. Il ne s’agit pas d’un jugement, mais de la formalisation d’une accusation. Concernant Netanyahu et Gallant, il existe « des motifs raisonnables de croire que les deux individus ont intentionnellement et sciemment privé la population civile de Gaza d'objets indispensables à sa survie, notamment de nourriture, d'eau, de médicaments et de fournitures médicales, ainsi que de carburant et d'électricité ».
- Qu'est-ce que cela signifie ? On ne peut ignorer le poids moral de cette nouvelle étape dans la procédure devant la CPI, largement saluée par les groupes de défense des droits humains. Toutefois, la Cour ne dispose pas de forces de police propres qui pourraient procéder à des arrestations ; cette responsabilité incombe aux États parties au Statut de Rome instituant la Cour. Benjamin Netanyahu, Yoan Gallant et Mohammed Deif (s’il était toujours en vie) devraient donc, en principe, être arrêtés s’ils se rendent sur le territoire de l’un des 124 États parties au Statut.
- Quelles ont été les réactions ? Le Haut Représentant de l’UE pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, a immédiatement souligné que les mandats d’arrêt de la Cour doivent être exécutés. Les Pays-Bas, l’Espagne, la Belgique, l’Italie et l’Irlande ont déjà déclaré qu’ils les appliqueraient. La France prend acte de la décision de la Cour et a rappelé son attachement à l’indépendance de la CPI, sans parler d’exécutions des mandats d’arrêt.
Quant au Premier Ministre Orban, dont le pays est pourtant partie au Statut de Rome et exerce la présidence européenne, il a immédiatement invité M. Netanyahu à lui rendre visite en Hongrie. Le Président des Etats-Unis (non-partie) conteste la compétence de la Cour et a qualifié la décision de la celle-ci de « scandaleuse ». Quant à M. Netanyahu, il a qualifié d’antisémites la Cour et ses décisions, qu’il a comparées à la condamnation du capitaine Dreyfus.
Christine Van Nieuwenhuyse
[1] Une des fonctions de la Chambre préliminaire consiste à donner ou non au Bureau du Procureur l’autorisation d’ouvrir une enquête. La Chambre détermine de manière préliminaire si une affaire relève de la compétence de la Cour, sans préjudice des décisions que la Cour pourrait prendre ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.
PAROLE A APNU JEUNES
La situation des Rohingya au Myanmar et au Bangladesh

Observer Reasearch Foundation
(Voir également l’article paru dans la précédente édition du Bulletin d’information sur le Myanmar)
Introduction
Les Rohingya sont une population à majorité musulmane, vivant dans l’Etat de Rakhine au Myanmar. Ils sont victimes de persécutions depuis plusieurs décennies de la part des autorités de ce pays à majorité bouddhiste, qui les considèrent comme apatrides et refusent de leur accorder la citoyenneté ou une identité ethnique légale. Les Rohingya ont cherché leur salut parfois dans la rébellion armée, comme d’autres groupes ethniques, mais surtout dans la fuite vers des pays voisins.
Au fil des vagues de répression, ce sont au total plus de 1,2 millions de personnes qui ont trouvé refuge au Bangladesh et en Malaisie notamment. Préoccupées surtout par les retombées politiques de ces afflux de population, les autorités du Bangladesh refusent de les régulariser, ce qui rend leurs conditions de vie extrêmement précaires. Le nouveau Premier Ministre ad interim Mohammed Yunus a toutefois fait récemment preuve d’une nouvelle volonté de rechercher des solutions . Dans l’Etat de Rakhine, le conflit a repris : les populations sont regroupées de force dans des camps de déplacés et les autorités ont imposé un blocus commercial qui menace de famine près de deux millions d’habitants, selon les Nations Unies.
Au Myanmar
La désillusion face à l’inaction du gouvernement civil
La victoire électorale de la prix Nobel de la paix, Aung Sang Suu Kyi en 2015 avait ravivé les espoirs de transition démocratique et d’un règlement du statut des Rohingya, qui d’ailleurs lui avaient exprimé leur soutien dans les années 90. Son gouvernement est pourtant resté silencieux sur la vague de répression militaire contre cette minorité en 2017 et il ne s’opposera jamais publiquement aux exactions de l’armée, ni aux nettoyages ethniques subis par les populations rohingya[1].
Sous la junte militaire depuis 2021
La junte ne manifeste jusqu’à présent aucune volonté de coopérer avec le Bangladesh sur le retour des Rohingya, ni sur l’octroi de leur citoyenneté. Alors que des mesures draconiennes leur ont été imposées quant à leur liberté de mouvement au Myanmar, la guerre entre Tadmataw (les forces armées du Myanmar) et les groupes armés ethniques accentue les risques liés à leur existence même. Regroupées dans des camps de déplacés internes, soumises au blocus économique par l’armée, menant à une très forte inflation, et à la privation des ressources de première nécessité, près de deux millions de personnes courent un risque accru de famine, en majorité des Rohingya.
Cette situation est qualifiée par les Nations Unies de « punition collective » envers les populations civiles[2]. Pire, les populations rohingya sont directement attaquées et ont vu des dizaines de leurs campements incendiés par Tadmataw et par l’Armée Arakanaise (groupe armé ethnique contrôlant la région), pourtant adversaires respectifs[3]. Cette violence est en partie due au recrutement forcé de combattants rohingya pour pallier le manque d’effectifs.
Comme mentionné dans l’article paru dans le précédent bulletin, le gouvernement central n’a aujourd’hui plus les moyens d’imposer sa vision politique aux Etats insurgés, ceux-ci ayant atteint un degré d’autonomie inédit. Le dialogue sur le rapatriement des Rohingya passera de plus en plus par les autorités contrôlant l’état de Rakhine de facto, c’est-à-dire l’Armée Arakanaise. Son chef s’est d’ailleurs montré favorable au retour des populations réfugiées au Bangladesh dans des conditions « dignes et humaines »[4]. Une solution à court terme est cependant toujours hors d’atteinte et ces déclarations ne doivent pas occulter la violence à laquelle les Rohingya sont encore soumis, la plus forte depuis 2017.
Au Bangladesh
La question des Rohingya est indissociable de leurs vagues de migration (forcée) vers le Bangladesh et de la gestion de cette migration par l’Etat bangladais. Plusieurs vagues majeures s’observent ainsi, notamment en 1978, 1991-1992, 2012, 2016, et 2017. Dans un premier temps, malgré des ressources limitées, le Bangladesh a ouvert sa frontière aux Rohingya fuyant le Myanmar.
À la suite de la vague de 1991-1992, ce sont plus de 20 camps qui sont mis sur pied afin d’accueillir 250 000 Rohingya, avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors que la fin de la décennie voit le retour d’une grande partie d’entre eux au Myanmar, 34.000 restent au Bangladesh et voient leur statut régularisé, ce qui leur donne droit à tous les services essentiels. Par la suite, le gouvernement bangladais refusera de reconnaître les populations rohingya entrantes comme des réfugiés. En effet, le Bangladesh n’est pas signataire de la Convention de 1951 et de son Protocole de 1967 relatifs au Statut des Réfugiés.
Un grand nombre de Rohingyas se sont donc regroupés à l’extérieur des camps « officiels ». Ces réfugiés non reconnus forment aujourd’hui la grande majorité des Rohingyas présents dans le pays. Conséquence des persécutions de 2017 au Myanmar, près d’un million de Rohingya vivent répartis sur plus de 32 camps de réfugiés informels. Ils sont encore aujourd’hui considérés par le gouvernement non pas comme réfugiés, mais comme des « Forcibly Displaced Myanmar Nationals », au grand dam des Nations Unies[5].
En 2017 le Bangladesh et le Myanmar signent un protocole d’accord afin de rapatrier les Rohingyas dans l’Etat de Rakhine mais cette offre de retour est refusée par les populations réfugiées. Ceci provoque un changement de discours au sein de la classe politique bangladaise sur la question de l’accueil des Rohingya. Leur présence de plus en plus “encombrante” devient associée à des risques de hausse de la criminalité, incluant les meurtres et narcotrafics, ainsi qu’à un risque de perte de contrôle des flux migratoires et donc, de la souveraineté nationale. De plus, les Rohingyas constituent une main-d'œuvre bon marché, prête à accepter les travaux les plus précaires, et sont désormais perçus comme une concurrence déloyale aux yeux des populations bangladaises voisines des camps de réfugiés.
En réaction, des mesures seront prises, dont la réorganisation administrative et l’augmentation des moyens de contrôle et de surveillance au sein des camps, ainsi que la limitation de la liberté de circulation des réfugiés (non-reconnus). Priorité est donc donnée à la sécurité nationale, et non plus à la sécurité des populations réfugiées[6].
Dans la même ligne est née l’idée du « stockage des réfugiés », qui consiste à les “parquer” dans des endroits où leur mobilité est de fait contrainte pour une période indéfinie. L'île de Bhasan Char est ainsi devenue ce lieu de “stockage”, malgré une forte opposition des Nations Unies invoquant des risques humanitaires et sécuritaires liés au climat (l'île est exposée aux inondations et à l’érosion des sols). Les conditions de vie y seraient aussi mauvaises que dans les camps informels pour les désormais 100 000 réfugiés qui y ont été déplacés (de gré ou de force).
Le Bangladesh se trouve ainsi bloqué entre, d’une part, la pression de la communauté internationale, et en premier celle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, pour que soit fournie une assistance plus durable et soutenue aux Rohingya et, d’autre part, sa pression domestique, étant donné sa forte densité de population, son manque de capacités et le mécontentement politique qui en résulte.
L’arrivée au pouvoir du Dr. Muhammad Yunus comme dirigeant par intérim du pays à la suite de la chute du Gouvernement en 2024 donnera peut-être un nouvel élan à la reprise du dialogue. Invoquant l’importance cruciale de la crise des rohingyas pour le Bangladesh mais aussi pour la stabilité régionale, M. Yunus a fait part de sa volonté à ramener les acteurs autour de la table à l’occasion d’une conférence de « toutes les parties prenantes » afin de « réévaluer la situation et élaborer des solutions innovantes ».
Il a appelé à la relance du Plan de réponse conjoint – lancé par les Nations Unies et le Bangladesh – pour remédier au manque de financement de l’aide aux Rohingyas. Enfin, il a souligné que la communauté internationale doit soutenir les efforts visant à garantir la justice pour le génocide commis contre les Rohingyas[7].
Quentin Moussebois et Selma Cherigui, APNU Jeunes
[3] https://www.aljazeera.com/news/2024/5/21/nowhere-to-go-rohingya-face-arson-attacks-in-myanmars-rakhine-state
[4] https://www.usip.org/publications/2024/09/out-spotlight-myanmars-rohingya-face-worst-violence-7-years
[5] Shohel, M. M. C., Rashedujjaman, S. M., & Akter, T. (2024). Relocation of the Rohingya Refugees to Bhasan Char: Human Rights, Government Policy, and the Refugee Crisis in Bangladesh. In Dealing With Regional Conflicts of Global Importance (pp. 279-298). IGI Global.
[6] Milton, A. H., Rahman, M., Hussain, S., Jindal, C., Choudhury, S., Akter, S., ... & Efird, J. T. (2017). Trapped in statelessness: Rohingya refugees in Bangladesh. International journal of environmental research and public health, 14(8), 942.