- Association pour les Nations Unies
- Posts
- Bulletin d'information | décembre - janvier 2025
Bulletin d'information | décembre - janvier 2025
Bulletin d'information | décembre - janvier 2025
Pour un meilleur confort de lecture, nous recommandons d’ouvrir le lien en ligne
Chers membres et sympathisant(e)s,
À l'Association pour les Nations Unies (APNU), notre mission est de tisser des liens entre nos membres et les Nations Unies. Grâce à votre soutien, nous continuons à éclairer, inspirer et mobiliser notre communauté sur les enjeux internationaux. Découvrez des articles et des mises à jours essentielles qui promettent d'enrichir votre connaissance des actions des Nations Unies à travers le monde.
Pour tout commentaire ou suggestion, n’hésitez pas à nous contacter ([email protected]).
DANS CETTE ÉDITION…
Mot de la Présidente, Francoise Tulkens
Priorités du Secrétaire général de l’ONU pour 2025
United Nations Associations (UNAs) Europe - Déclaration commune « Le multilatéralisme menacé »
Pacte de l’Avenir: Réunion d'information au SPF Affaires étrangères 28/11/2024
Les ateliers de l’Académie sur le droit humanitaire
Note de lecture: La médiation diplomatique internationale, de Raoul Delcorde
Syrie: Quel rôle pour l’ONU?
Audiences historiques à la CIJ : un tournant dans la lutte mondiale contre le changement climatique?
Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification
Conflit Israël-Hamas: L’UNRWA cessera-t-elle d’opérer en 2025? Un désastre annoncé. Carte de blanche de Philippe Lazzarini
27 janvier: Commémoration de la mémoire des victimes de l’Holocauste
Crises oubliées : Haïti
Le Forum des Jeunes lance la sélection 2025-2026 des délégué·es ONU
A LA UNE
Mot de la Présidente de l’APNU, Francoise Tulkens

Le Conseil d’administration de l’APNU se joint à moi pour vous adresser nos voeux les plus sincères. Merci de votre fidélité, de votre soutien et de votre engagement. Que cette nouvelle année, en dépit des incertitudes et des défis complexes, soit synonyme d’espoir, de résilience et de solidarité.
Dans un monde marqué par des tensions internationales, des crises humanitaires et des défis globaux, les Nations Unies jouent un rôle crucial, qui se voit parfois entravé. Plus que jamais, leur mission fondamentale est de promouvoir la paix, les droits humains et le développement durable. Elles ont besoin du soutien fort et renouvelé de tous.
L’année 2024 a été marquée par des conflits persistants en Ukraine, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2025, l’APNU restera donc mobilisée pour promouvoir la paix, la sécurité internationale et le multilatéralisme, ainsi que la lutte contre le changement climatique et le développement durable.
Dans le prolongement du “Sommet de l’Avenir”, qui s’est tenu à l’ONU en septembre 2024, notre association continuera à alimenter la réflexion sur le renforcement de la coopération multilatérale et de la gouvernance mondiale. Nous nous attacherons également à sensibiliser le public à l’importance du droit international et à suivre de près la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Cette année encore, l’APNU travaillera en étroite collaboration avec son homologue néerlandophone, la VVN. Nous renforcerons aussi notre collaboration avec les autres Associations pour les Nations Unies européennes francophones, et notamment française, luxembourgeoise et suisse.
Enfin, l’APNU continuera de publier régulièrement son bulletin d’information, enrichi par les contributions précieuses d’experts des Nations Unies et de spécialistes du droit international.
Ensemble, faisons de 2025 une année d’actions et d’espoir pour un monde plus pacifique et durable. Que chacun, à son niveau, continue à défendre les principes du multilatéralisme et de la coopération internationale.
Priorités du Secrétaire général de l’ONU pour 2025

Source ONU
2025 marque le 80e anniversaire de l’Organisation des Nations Unies. “Contre vents et marées, le monde s’est rassemblé au sein de l’ONU pour affronter certains problèmes les plus inextricables” ...”l’ONU est le reflet d’une vérité essentielle : les problèmes mondiaux exigent des solutions mondiales” a déclaré le Secrétaire général de l’ONU lors de la présentation de ses priorités pour cette année, le 15 janvier dernier, devant l’Assemblée générale.
Commençant cette fois par quelques bonnes nouvelles, le Secrétaire général a évoqué : le cessez-le feu au Liban, la trêve entre Israël et le Hamas, les progrès réalisés en matière d’énergies renouvelables, dans lesquelles le monde investit désormais deux fois plus que dans les énergies fossiles, la réduction de la mortalité infantile, la progression notable de la parité filles-garçons dans l’éducation, les mesures de protection des océans...
Cela ne peut faire oublier que “le monde est dans la tourmente” et menacé par le déchaînement des conflits, les inégalités généralisées, la crise climatique et des développements technologiques incontrôlés. Mais il ne faut jamais perdre l’espoir.
Pour le Secrétaire général, le Pacte de l’avenir adopté par les chefs d’Etat et de gouvernement en septembre dernier, avec le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures, offre des éléments de réponse pour faire face à cette “boîte de Pandore “moderne.
En conclusion, M. Guterres a réaffirmé la capacité de l’ONU à guider le monde vers des solutions inclusives et durables face aux défis actuels.
United Nations Associations (UNAs) Europe
Déclaration commune « Le multilatéralisme menacé »

A l’initiative de la WFUNA (Fédération mondiale des UNAs), les 16 UNAs d’ Europe se sont réunies les 5 et 6 décembre dans les bureaux de l’UNRIC à Bruxelles. UNA Belgium (APNU/VVN) a participé activement à ces 2 jours de réflexion commune.
La réunion a été l'occasion d’un échange enrichissant sur les défis actuels au multilatéralisme, ainsi que sur le rôle et le programme de travail de chacune des UNAs représentées. En dépit des différences, en termes de membres, de ressources et d’activités, toutes les UNA’s présentes ont confirmé leur engagement à renforcer les efforts de plaidoyer en soutien aux Nations Unies et au multilatéralisme, avec une attention particulière portée aux jeunes.
2025 marquera les 80 ans de l’ONU. Priorité sera donnée à la mise en œuvre du Pacte de l’avenir et de ses axes principaux : le désarmement nucléaire, la gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle, la réforme de l’architecture financière mondiale et la prise en compte des générations futures.
D’importants rendez-vous internationaux s'y prêtent particulièrement : la Conférence sur l'océan à Nice, la Conférence sur le financement du développement à Séville, le Deuxième sommet mondial pour le développement social au Qatar, la Conférence des Parties sur le changement climatique (COP30) au Brésil. Le plan de travail 2025 de l’APNU est aligné sur cet agenda et le Centre régional d’information des Nations Unies à Bruxelles est prêt à collaborer avec l’APNU et les autres UNAs à sa mise en œuvre.
La réunion a aussi permis l’adoption d’une déclaration commune sur les menaces qui pèsent sur le multilatéralisme.
Myrta Kaulard, administratrice APNU
Pacte de l’Avenir: Réunion d'information au SPF Affaires étrangère 28/11/2024

La Direction des Nations Unies du SPF Affaires étrangères a organisé, le 28 novembre, une réunion d'information sur le Pacte de l'Avenir, à l'intention de la société civile, en présence de Rory Keane, directeur du Bureau des Nations Unies sur la paix et la sécurité à Bruxelles (UNLOPS) et de Elisabeth Diaz Hochmann du Bureau de Coordination des Nations Unies sur le Développement. Les intervenants ont éclairé certains des aspects les plus concrets ou novateurs du Pacte : réformes de la gouvernance mondiale, accès aux financements, désarmement nucléaire, espace, intelligence artificielle, rôle des jeunes, générations futures.
L'évolution de la situation mondiale confirme à la fois l'importance de la coopération internationale et l'urgence de restaurer la confiance dans le multilatéralisme, comme l'avaient souhaité les chefs d'Etat lors du 75e anniversaire de l'ONU. En ce sens, l'adoption par consensus du Pacte pour l'Avenir par l'Assemblée générale peut être saluée comme un succès. Mais le Pacte, un document très large qui couvre une diversité de sujets, et ses 56 "actions" ne sont sans doute pas aussi percutants que beaucoup l'auraient souhaité (voir article dans Bulletin précédent).
Pour la Belgique, comme pour l'UE, il s'agissait surtout de renforcer la gouvernance multilatérale de problématiques émergentes, tels que le climat, l'innovation technologique, l'intelligence artificielle, l'exploration et l'utilisation de l'espace. Les références plus assertives aux droits humains dans le Pacte sont également à saluer. Pour les pays en développement en revanche, la priorité devait être donnée à la réduction de la pauvreté et des inégalités et à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, avec pour conséquence des accents moindres sur l'urgence climatique dans le texte final.
En matière de paix et de sécurité, vu l'acceptation grandissante par les sociétés de la violence, en interne et dans les rapports entre Etats, il est urgent de remettre la priorité sur la prévention, et de recourir davantage à l'action diplomatique et aux bons offices du Secrétaire général, pour éviter les conflits. Les Etats ont aussi la responsabilité de promouvoir des relations pacifiques chez eux et dans leurs relations internationales. Le Pacte contient des engagements renouvelés sur le désarmement nucléaire, dans un contexte modifié par l'apparition de nouvelles puissances nucléaires potentielles. Enfin, les Etats doivent s'engager dans la voie d'une interdiction de l'usage à des fins militaires de nouveaux domaines, tels que l'espace et l'intelligence artificielle. La réforme du Conseil de sécurité n'a guère progressé, mais le Pacte enregistre formellement l'état actuel des négociations ; toutefois sans une adaptation du droit de veto, la seule révision de la composition du Conseil pour en améliorer la représentativité ne garantira pas l'efficacité de son fonctionnement.
En matière de développement, les Etats ont reconfirmé leur engagement à mettre en œuvre les ODD d'ici à 2030, une perspective qui semble pourtant s'éloigner. L'accès au financement pour le développement et la transition climatique demeure un obstacle majeur pour les pays en développement, comme l'ont encore démontré les récentes COP sur la biodiversité et sur le climat. D'où l'insistance du Pacte sur la nécessaire réforme des institutions financières internationales. Par ailleurs sans une gouvernance mondiale de l'IA, le risque est grand pour les pays en développement de manquer les opportunités qu'elle présente.
L'inclusion de la parole et des intérêts des jeunes dans la formation et la prise des décisions aux Nations Unies est désormais un acquis de principe. Reste à développer les modalités concrètes de cette participation, au sein de l'organisation mais aussi dans les Etats membres, pour la rendre efficace. En ce qui concerne la Belgique, depuis plusieurs années, les représentants de la jeunesse sont invités à participer aux réunions des Nations Unies. Ceci ne doit pas faire perdre de vue l'application et la protection de l'acquis en matière de droits de l'enfant.
Elément nouveau, en annexe du Pacte figure aussi une Déclaration sur les générations futures, insistant sur la nécessité de tenir compte des intérêts des générations à venir dans la définition et l'élaboration des politiques publiques, ce qui devrait engager les décideurs à se projeter d'avantage dans l'avenir. Le Secrétaire général devrait sous peu désigner un Envoyé spécial chargé de cette problématique.
La mise en œuvre du Pacte sera aussi examinée aux prochains événements inscrits au calendrier de l'ONU : la COP sur la lutte contre la désertification en décembre 2024, la Commission de la condition de la femme de mars 2035 lors de l'examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du plan d'action de Beijing, 30 ans après leur adoption, le Deuxième Sommet mondial pour le Développement social de mars 2025 et la Conférence sur le Financement du Développement de Séville en juillet 2025.
De l’avis des intervenants, la société civile, le monde académique et les « think tanks » sont des partenaires et des relais très utiles, qui peuvent intervenir auprès des gouvernements et les encourager à mettre en œuvre leurs engagements. L'échange animé avec la salle, qui a suivi les présentations, a pourtant pointé à nouveau l'écart entre les promesses faites à l'ONU et les lacunes des politiques nationales, y compris en Belgique, un sujet de frustration pour de nombreux participants.
Bénédicte Frankinet, administratrice APNU
Les ateliers de l’Académie sur le droit humanitaire
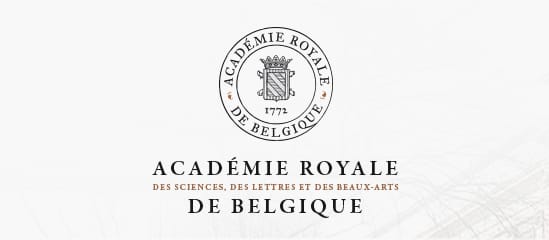
La Collège Belgique est une institution de formation et d’enseignement créée au sein de l’Académie Royale de Belgique qui vise la diffusion du savoir et le développement d’une réflexion critique pour construire une société éclairée. Dans tous les domaines, le Collège propose, chaque année, un programme de plus d'une centaine de cours-conférences de niveau universitaire, gratuits et accessibles à un large public.
Ces cours sont dispensés par des académiciens, des professeurs d'université, des chercheurs, des écrivains et des personnalités reconnues pour leurs expertises dans le domaine enseigné. À ce titre, le Collège Belgique se rapproche d'une organisation de type université ouverte.
Il a organisé en novembre 2024 un cycle de cours sur le droit international humanitaire à l’épreuve de la guerre. En hommage au professeur Eric David une figure incontournable dans ce domaine, cette initiative fait partie des activités du Comité pour une paix durable qui a été institué à l’Académie en 2020.
Dans le contexte de la situation en Ukraine et à Gaza, les professeurs Raphaël van Steenberghen (UCLouvain) et Vaios Koutroulis (ULB) ont analysé les principes généraux du droit des conflits armés (ius in bello et ius post bellum). L’interdiction du recours à la force, sauf la légitime défense, (article 1er de la Charte des Nations Unies) a fait l’objet du cours donné par le professeur Olivier Corten (ULB).
Le rôle pionnier du Tribunal de Nuremberg, les crimes internationaux, notamment le crime d’agression (crime contre la paix), définis par le Traité de Rome de 1998 qui institue la Cour pénale internationale, ont été présentés par les professeurs Damien Vandermeersch (UCLouvain) et Christophe Deprez (ULiège) tandis que la position de la Cour internationale de justice sur la notion génocide a fait l’objet du cours du professeur Pierre d’Argent (UCLouvain). Les conclusions ont été dégagées par Emmanuel Klimis, administrateur de l’APNU et professeur à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles qui a ouvert les perspectives sur d’autres horizons et d’autres conflits.
L’ensemble des leçons est accessible sur Youtube de l’Académie Royale.
Pour des ouvrages récents :
A . Clapham,War, Oxford University Press, 2021
E. David, Nuremberg. Droit de la force et force du droit, Bruxelles, Racine 2022
E. David, V. Koutroulis, Fr. Tulkens, D. Vandermeersch, R. Van Steenberghen, Code de droit international humanitaire – International Humanitarian Law, Bruxelles, Larcier, 2024
Francoise Tulkens
ARTICLES THÉMATIQUES
Notes de lecture
La médiation diplomatique internationale, de Raoul Delcorde
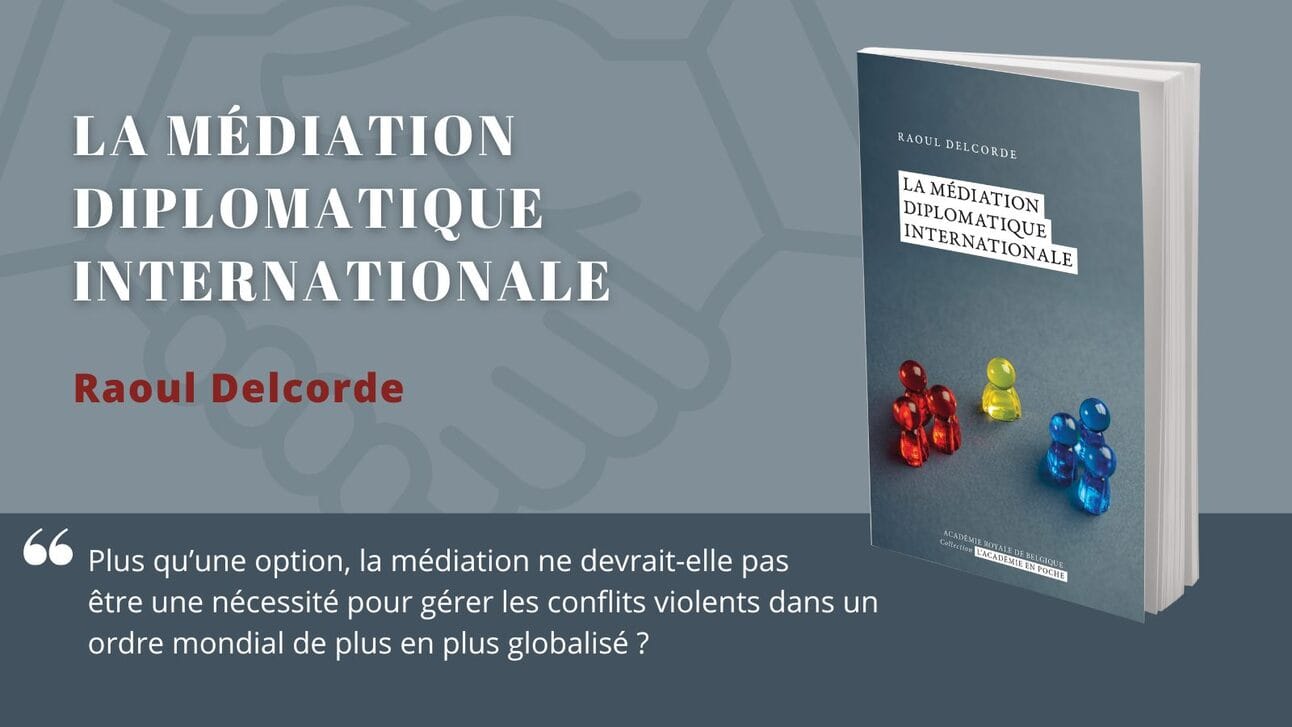
Une médiation était-elle possible au cours des semaines qui ont précédé l’attaque de la Russie contre l’Ukraine en février 2022 ? Quels rôles les Etats-Unis, l’Egypte et le Qatar jouent-ils dans les négociations indirectes entre Israël et le Hamas ? L’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU en Syrie peut-il contribuer à l’émergence d’un accord de gouvernement entre parties, dans un contexte marqué par les ingérences de puissances extérieures ? Comment les Emirats arabes unis sont-ils devenus un acteur incontournable des échanges de prisonniers russes et ukrainiens ?
A l’heure où le recours à la force fait son grand retour et où, loin de s’apaiser, les conflits semblent reprendre vigueur, il est temps d’accorder aux missions de bons offices et de médiation l’attention qu’elles méritent. L’ouvrage de Raoul Delcorde, consacré à la médiation diplomatique internationale, à son évolution historique et à sa complexité, arrive à point nommé.
Chacun s’accorde, en théorie du moins, sur le rôle et l’importance de la médiation comme instrument non seulement de gestion et de règlement des conflits internationaux, mais aussi de prévention.
Avec le temps, les acteurs dans ce domaine se sont multipliés et diversifiés, qu’il s’agisse d’Etats tiers, d’organisations internationales, comme l’ONU et l’Union africaine, ou de grandes organisations non gouvernementales.
Mais la volonté réelle des parties à un différend ou à un conflit de parvenir à un accord, les qualités personnelles et professionnelles du médiateur, son degré d’impartialité et d’acceptation par les parties, les soutiens extérieurs dont il peut bénéficier, la durée de son investissement et les moyens de persuasion à sa disposition peuvent constituer autant de facteurs de réussite ou, le cas échéant, d’échec. Si les leçons tirées de l’histoire doivent être mises à profit, il faut constater qu’aucune médiation ne ressemble entièrement à une autre, en particulier celles qui visent à mettre fin à un violent conflit armé.
Un travail comparatif minutieux a mené l’auteur à dresser d’intéressantes typologies des stratégies de médiation, des médiateurs, des circonstances dans lesquelles ils ont travaillé, ainsi que des facteurs de succès et d’échec. Elles ont le mérite d’une grande clarté. De nombreux exemples tirés de l’histoire diplomatique viennent illustrer, mais aussi humaniser, le propos : le conflit frontalier Iran-Irak résolu sous égide algérienne en 1975, les accords de Dayton sur la guerre de Bosnie en 1995, la fin de la guerre civile entre Renamo et Frelimo au Mozambique en 1992, obtenue grâce à la médiation de Sant’Egidio, assisté par l’ONU... Des portraits de médiateurs célèbres en action, comme Richard Holbrooke et Lakhdar Brahimi, complètent le tableau.
En conclusion, l’auteur plaide vigoureusement en faveur de la médiation comme instrument de gestion des tensions et différends internationaux, mais aussi pour un investissement plus vigoureux et volontariste des gouvernements et des organisations internationales dans cette approche pacifique du règlement des conflits.
Raoul Delcorde est ambassadeur honoraire de Belgique et membre de l’Académie royale de Belgique. Il est professeur invité à l’UCLouvain.
La médiation diplomatique internationale, par Raul Delcorde, Académie Royale de Belgique, Collection l’Académie en poche, 2024, 142 pages
Bénédicte Frankinet
A RETENIR
Avantages de la médiation diplomatique internationale :
Approche pacifique : Elle offre une alternative aux solutions militaires ou coercitives, réduisant ainsi les pertes humaines et les destructions matérielles.
Neutralité : Les médiateurs internationaux, souvent des organisations ou des individus neutres, peuvent aider à créer un climat de confiance entre les parties.
Soutien à long terme : Le résultat de la médiation ne se résume pas seulement à l’obtention d’un cessez-le-feu ; il peut inclure des engagements pour des solutions durables, comme des réformes politiques ou économiques.
Participation multilatérale : L’implication de plusieurs acteurs (ONU, Union africaine, Union européenne, etc.), renforce la légitimité des accords conclus.
Adaptabilité : La médiation permet des solutions sur mesure adaptées aux spécificités culturelles, politiques et économiques des parties en conflit.
Limites ou défis :
Manque de volonté politique : Si les parties en conflit ne sont pas prêtes à négocier de bonne foi, la médiation peut échouer.
Ressources limitées : Les médiateurs peuvent manquer de moyens financiers, humains ou techniques pour mener des négociations complexes.
Interférences externes : Les intérêts divergents des puissances mondiales ou régionales peuvent compliquer le processus de médiation.
Impartialité contestée : Les médiateurs doivent être perçus comme neutres, ce qui n’est pas toujours évident.
Résultats non contraignants : La mise en oeuvre des accords issus d’une médiation dépend souvent de la bonne volonté des parties.
Enjeux pour l’avenir :
Renforcer les capacités des médiateurs.
Favoriser des approches inclusives qui impliquent la société civile et les groupes marginalisés.
Intégrer davantage les nouvelles technologies pour surveiller et garantir la mise en œuvre des accords.
La médiation diplomatique internationale est un outil indispensable, dont l’efficacité dépend d’un engagement collectif et d’efforts coordonnés.
Syrie: Quel rôle pour l’ONU?

Le 8 décembre 2024, Bachar al-Assad a été destitué après 24 ans d'un mandat marqué par des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre contre sa propre population. Quel rôle l'ONU a-t-elle joué pendant les longues années du conflit syrien? Quel rôle pourrait-elle jouer à l'avenir?
En avril 2011, la répression brutale de manifestations pacifiques par le régime syrien dégénère en affrontements armés, et puis en une guerre civile meurtrière. Celle-ci verra s’affronter, entre autres, forces gouvernementales, milices d’obédience diverse, terroristes de Daech, rebelles kurdes... Au terme de 13 années, le conflit aura fait plus d’un demi-million de morts, dont près de 200.000 civils, plus de 5 millions de réfugiés et autant de déplacés internes. Devant l’ampleur et la brutalité du conflit, compliqué encore par l’implication militaire et le double jeu de puissances extérieures (Russie, Turquie, mais aussi Etats-Unis), les Nations Unies ont été bien en peine de jouer un rôle décisif. Au Conseil de sécurité, la Russie, alliée du président Assad, suivie à plusieurs reprises par la Chine, a opposé 14 fois son veto à des projets de résolution sur le conflit syrien, y compris concernant l'aide humanitaire.
Au début 2012, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, et la Ligue arabe avaient pourtant désigné un envoyé spécial commun pour la Syrie, en la personne de Kofi Annan, lui-même ancien SG des Nations Unies. Le Conseil de sécurité autorisait en même temps le déploiement d’une force de supervision de 340 observateurs de l'ONU (UNSMIS) sur le terrain : il sera prématurément mis fin à leur mission en raison de la violence des combats. Après l’échec, au bout de 6 mois, de son plan pour une transition politique et un partage du pouvoir en Syrie, Kofi Annan jetait l’éponge. D'autres envoyés du Secrétaire général, comme Staffan de Mistura, ou actuellement Geir Pedersen, lui ont succédé, sans que leur action ne permette finalement de progresser vers un apaisement du conflit.
En 2013, le Conseil de sécurité retrouvait temporairement son unanimité pour condamner l'attaque au gaz sarin menée contre les civils de la Ghouta par les forces gouvernementales syriennes et imposer la destruction de l'arsenal chimique syrien sous la supervision de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. Son adhésion - forcée - à la Convention sur les armes chimiques n’a pas empêché par la suite le régime syrien de contourner ses obligations et de recourir à nouveau à plusieurs reprises à l’usage de ces armes interdites.
En 2015, nouvel espoir. Suite aux efforts intenses de S. de Mistura auprès des diverses parties syriennes, le Conseil de sécurité, adoptait à l'unanimité la résolution 2254 sur un "processus de paix" en Syrie. Cessez-le feu sur l'ensemble du territoire syrien, fin de la violence armée et des détentions arbitraires, rétablissement de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie et processus politique inclusif mené par les Syriens eux-mêmes constituaient, aux termes de celle-ci, les principaux éléments de l'amorce d'une solution. La résolution restera au final lettre morte, la mauvaise volonté des parties et les intérêts divergents des membres permanents l'emportant, mais elle reste aujourd'hui une référence.
Après cette déconvenue, les Nations Unies ont finalement dû se contenter de gérer l'aide humanitaire, non seulement sur le terrain, mais aussi au Conseil de sécurité. Face au gouvernement syrien et à ses alliés au Conseil, il a fallu notamment négocier pied à pied l'accès humanitaire, y compris aux populations des régions échappant au contrôle au contrôle gouvernemental. En dépit de ces efforts, et des circonstances difficiles dans lesquelles elles ont dû opérer, les agences humanitaires onusiennes ont parfois fait l'objet de critiques sur leur proximité avec les instances officielles syriennes.
En décembre 2024, sous la poussée des miliciens du HTS, le Président Assad et ses proches quittent précipitamment la Syrie à destination de Moscou. Un nouveau pouvoir s'installe à Damas. Le 17 décembre 2024, le Conseil de sécurité adopte une déclaration à la presse, dans laquelle, se référant à la résolution 2254 de 2015, il demande expressément la fin des ingérences extérieures et la mise en oeuvre d'un processus politique dirigé et contrôlé par les Syriens, facilité par les Nations Unies, en l'occurence l'envoyé spécial Geir Pedersen. Le Conseil demande aussi la poursuite de la lutte contre le terrorisme, le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Dans ses interventions au Conseil, M. Pedersen n'a pas dissimulé la complexité et les multiples défis de la tâche qui attend l'ONU et la communauté internationale.
Par ailleurs, le 6 décembre 2024, le Conseil de sécurité reconduit pour 6 mois le mandat de la Force des Nations Unies pour l'observation du dégagement - FNUOD (résolution 2766, présentée par la Russie et les Etats-Unis). Les casques bleus de cette force de l'ONU, chargée d'observer le désengagement militaire sur le Golan syrien depuis 1974, ont été pris au dépourvu par le déploiement, "préventif et temporaire" selon l'Etat hébreu, de soldats israéliens dans cette zone en principe démilitarisée, au lendemain du renversement du régime syrien.
Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est rendu en Syrie en janvier 2025. Il a insisté sur importance de la justice transitionnelle "qui vise à reconnaître les victimes, à renforcer la confiance des individus dans les institutions de l'Etat, à consolider le respect des droits de l'homme et à promouvoir l'Etat de droit".
Vu l'ampleur des atrocités commises, la transition syrienne doit aussi être une transition vers la justice. Le Haut-Commissariat a du reste mandaté une équipe d'enquêteurs pour rassembler des preuves sur les atrocités commises et l'ONU appelle à une coordination internationale pour les protéger et rendre justice aux victimes.
La chute du régime Assad a bien entendu changé entièrement la donne, mais la situation sur le terrain reste incertaine. Le rôle d'accompagnement que pourront jouer le Conseil de sécurité et les Nations Unies dans la transition syrienne l'est tout autant : le morcellement ethnique et religieux du pays, les groupes armés, la résurgence potentielle du terrorisme, l'ampleur de la tâche de reconstruction et de réconciliation, les interférences potentielles d'acteurs de la région et au-delà, ainsi que les divergences entre membres permanents sont autant d'obstacles potentiels sur la voie d'une normalisation.
Bénédicte Frankinet
Audiences historiques pour le climat à la CIJ : Un tournant dans la lutte mondiale contre le changement climatique?

© ICJ/Frank van Beek
Du 2 au 13 décembre 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a accueilli les présentations orales d’avocats et de représentants de 98 États ainsi que de 12 organisations internationales. Les trois principaux émetteurs de gaz à effet de serre, à savoir la Chine, les Etats-Unis et l'Inde, figuraient parmi ces intervenants.
Ces audiences résultent d’une demande d’avis adressée à la Cour en mars 2023 par l’Assemblée générale des Nations unies, à l'initiative du Vanuatu. Les deux questions posées à la Cour concernent, d’une part, la définition des obligations des Etats, en vertu du droit international, pour assurer la protection du système climatique et, d’autre part, les conséquences juridiques auxquelles feraient face les Etats qui causeraient des dommages à ce système.
Pour mémoire, l’accord de Paris de 2015 prévoit de limiter le réchauffement global de la planète à 1,5 degré Celsius, par rapport à l’ère préindustrielle. Cependant, notamment selon le Global Carbon Project, les émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles ont continué d'augmenter : 2024 a été l’année la plus chaude depuis le début des relevés de température en 1850 et la hausse de la température globale a franchi pour la première fois le seuil de 1,5 degré.
Pourtant les travaux de la COP 29 se sont concentrés principalement sur le financement de la lutte contre le changement climatique (300 milliards par an d’ici 2035, obtenus de haute lutte par les pays en développement) et sur l’amélioration de la transparence et du fonctionnement du système des crédits-carbone. La COP 30 (Belem, Brésil, 2025) devra pour sa part aborder l’incontournable révision à la hausse des ambitions nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de respecter la trajectoire nécessaire pour atteindre l’objectif global de 1,5°. La nouvelle administration américaine pourrait venir entraver les progrès dans ce domaine. .
Bien que l'avis de la CIJ soit consultatif, il pourrait avoir un poids moral et légal important et marquer un tournant dans la lutte mondiale contre le changement climatique : en guidant les négociations diplomatiques ou en éclairant des procédures judiciaires ultérieures, comme les procès liés au climat dans le monde, y compris ceux de petits États insulaires demandant réparation aux pays développés pour des dommages climatiques historiques.
Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, estime que l’avis encouragera les États à "prendre des mesures plus audacieuses et plus fortes en matière de climat dont notre monde a si désespérément besoin".
Bénédicte Frankinet
Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification

Lorsque les terres sont dégradées ou frappées par la sécheresse, elles perdent leur capacité à soutenir la vie, avec une série de conséquences, des mauvaises récoltes aux migrations et aux conflits. À l'échelle mondiale, 23 % des terres ne sont plus productives. 75 % ont été transformées, principalement pour l'agriculture. Cette transformation s’accélère depuis 50 ans.
Voilà pourquoi en 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio, les Etats membres de l’ONU ont lancé le processus d’élaboration d’une convention pour lutter contre ces phénomènes, (en même temps que deux autres conventions plus connues, pour le climat et la biodiversité). La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) a été adoptée à Paris en 1994 et est entrée en vigueur en décembre 1996.
Elle est le seul cadre juridique mondial mis en place pour lutter contre la désertification et les effets de la sécheresse. Elle réunit 197 parties, 196 Etats et l’Union européenne. Fondée sur les principes de participation, de partenariat et de décentralisation, elle constitue un engagement multilatéral visant à atténuer l’impact de la dégradation des terres et à les protéger.
La Convention réunit gouvernements, scientifiques, décideurs politiques, secteur privé et communautés autour d'une vision commune visant à restaurer et à gérer les terres de la planète.
Fonctionnement
La Conférence des parties (COP) est l’organe décisionnel principal pour la mise en œuvre de la Convention. Elle examine les rapports soumis par les Parties sur la mise en œuvre de leurs engagements et formule des recommandations sur cette base. Elle peut adopter des amendements ou des dispositions complémentaires à la Convention, telles que des annexes de mise en œuvre régionales supplémentaires. Depuis 2001, la COP se réunit tous les deux ans et a tenu un total de 16 sessions. La dernière s’est tenue du 2 au 13 décembre 2024 à Riyad, en Arabie saoudite.
La mise en œuvre de la Convention est appuyée par un Secrétariat basé à Bonn, un Mécanisme mondial pour faciliter la mobilisation des ressources financières, un Bureau d’évaluation indépendant, un Comité de la science et de la technologie (CST) chargé de fonder les décisions sur une base scientifique au travers de l’interface science/politiques et du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention (CRIC) .
Principales étapes récentes
Après le « Plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention pour la période 2008-2018 » adopté en 2007, la COP-13 a adopté en 2017 le Cadre stratégique 2018-2030 de la CNULCD, avec cinq objectifs stratégiques destinés à guider les actions des parties prenantes :
Améliorer l’état des écosystèmes affectés, lutter contre la désertification/dégradation des terres, promouvoir une gestion durable des terres et contribuer à la neutralité de la dégradation des terres,
Améliorer les conditions de vie des populations affectées,
Atténuer, s'adapter et gérer les effets de la sécheresse afin de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes vulnérables,
Générer des avantages environnementaux mondiaux grâce à la mise en œuvre efficace de la CNULCD,
Mobiliser des ressources financières et non financières substantielles et supplémentaires pour soutenir la mise en œuvre de la Convention en établissant des partenariats efficaces aux niveaux mondial et national.
Aucun des objectifs et des cibles n’ont cependant été chiffrés, chaque pays étant supposé fixer ses propres objectifs volontaires, en particulier en matière de neutralité de la dégradation des terres (NDT).
Selon un récent examen à mi-parcours du cadre stratégique, au vu de l’évolution de la dégradation des terres, 1,5 milliard d’hectares devraient être gérés durablement ou restaurés pour atteindre la NDT. Cependant, les Etats parties prévoient actuellementde ne restaurer qu’un peu plus d’un milliard d’hectares d’ici à 2030.
Certains projets méritent une attention particulière. C’est le cas de l’initiative « Grande Muraille Verte », lancée en 2007 par l’Union africaine et reprise dans le cadre des travaux de la Convention, pour lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse dans la région du Sahel et au-delà. En 17 ans, elle a permis de restaurer 20 millions d’hectares de terres, de créer 350 000 emplois et de générer 90 millions de dollars É.-U.
Depuis 2021, l’accélérateur de cette initiative, géré par le Mécanisme mondial, a permis de résoudre les problèmes pratiques rencontrés par les partenaires opérationnels et de renforcer le suivi des contributions d’un montant de 19 milliards de dollars É.-U. annoncées lors du One Planet Summit. Financé par l’Irlande et l’Autriche, cet accélérateur permet de recenser les possibilités de financement, de rapprocher sources de financement et projets à financer et de suivre les effets des projets.
COP-16: décembre 2024
Deux semaines de négociations n’ont pas permis de parvenir à un accord contraignant sur la lutte contre la sécheresse. Les pays participants se sont toutefois engagés à placer la restauration des terres et la résilience à la sécheresse au cœur des politiques nationales et de la coopération internationale. Ils ont également réalisé des progrès significatifs dans les négociations d’un futur régime mondial sur la sécheresse, qu’ils prévoient de finaliser lors de la COP17 en Mongolie en 2026.
Parmi les principales avancées de la COP16 figurent la création d’un Caucus pour les peuples autochtones et d’un Caucus pour les communautés locales, afin de garantir que leurs perspectives et défis particuliers soient pleinement représentés; la poursuite des travaux du groupe Science-Politiques de la Convention pour renforcer la base scientifique des décisions; ainsi que la mobilisation du secteur privé dans le cadre de l’initiative Business4Land.
Quant aux financements, de nouveaux engagements ont été annoncés pour des projets à grande échelle de restauration des terres et de préparation à la sécheresse, tels que le partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse, qui a attiré 12,15 milliards de dollars pour soutenir 80 des pays les plus vulnérables, dont un engagement de 10 milliards dollars du Groupe de coordination arabe. Mais, le Secrétariat estime qu’au moins 2.600 milliards de dollars d’investissements sont nécessaires d’ici 2030 pour restaurer plus d’un milliard d’hectares de terres dégradées et renforcer la résilience face à la sécheresse, soit un investissement quotidien de 1 milliard de dollars.
André Hupin, Secrétaire général
Conflit Israël-Hamas
L’UNRWA cessera-t-elle d’opérer en 2025? Un désastre annoncé

ONU Photo/Mark Garten
Les députés israéliens ont adopté une loi interdisant à l’UNRWA d’opérer en Israël et à Jérusalem-Est. Cette interdiction devrait entrer en vigueur fin janvier 2025, 90 jours après son adoption par la Knesset, le parlement israélien (voir notre bulletin de novembre 24).
L’UE et de nombreux dirigeants européens et occidentaux ont exprimé leur réprobation à la suite de ce vote. Article UNRIC pour plus d’informations
Le 11 décembre 2024, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, par une large majorité, une résolution proclamant son soutien total à l'UNRWA et déplorant la législation adoptée par la Knesset.
Le gouvernement israélien n’en a pas moins maintenu ses positions.
De plus, l’indignation soulevée par ce projet de mettre fin aux activités de l’UNRWA et aux opérations de l’agence essentielles pour la population palestinienne, semble aujourd’hui en grande partie dissipée. « L’enjeu est plus important que jamais, et le temps presse. » déclare Philippe Lazzarini, Commissaire Général de l’ UNRWA. Il a affirmé que l’UNRWA continuera à fournir de l’aide aux populations dans les territoires palestiniens, en dépit de son interdiction par Israël « Nous resterons et remplirons notre mission » a-t-il déclaré . Cela ne se fera certainement pas sans risques pour l’agence et pour ses employés
Pour comprendre les enjeux liés à cette interdiction, nous vous invitons a lire, la tribune de Philippe Lazzarini datée du 20 décembre 2024, parue dans divers quotidiens.
Christine Van Nieuwenhuyse
27 janvier: Commémoration de la mémoire des victimes de l’Holocauste

Plantation d'un arbre au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York pour commémorer l'héritage d'Anne Frank. Photo ONU/Mark Garten
La date du 27 janvier marque, cette année, le 80e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau. Les Nations Unies se sont associées aux commémorations du génocide perpétré contre les Juifs par le pouvoir nazi et ses soutiens.
En 2005, par sa résolution 60/7, l’Assemblée générale de l’ONU a proclamé le 27 janvier Journée internationale pour la commémoration de la mémoire des victimes de l’Holocauste. Elle a également chargé le Secrétaire général de l’ONU de mettre en place un programme d’éducation sur « les Nations Unies et l’Holocauste » et d’élaborer des mesures pour mobiliser la société civile pour des actions de mémoire et d’éducation relatives à l’Holocauste.
Une nouvelle résolution de l’Assemblée générale a été adoptée en 2022 pour condamner toute négation de l’historicité de l’Holocauste.
Dans un monde où se multiplient les discours de haine et les manifestations d’extrémisme et d’antisémitisme, le Secrétaire général Antonio Guterres appelle à la mémoire collective et à la vigilance constante. Il souligne l'importance de se souvenir des tragédies passées comme l'Holocauste et d'agir fermement contre toutes les formes de haine, notamment l'antisémitisme, le racisme et le sectarisme. Lire son discours
APNU JEUNES
Crises oubliées : Haïti

Haïti fut l’un des premiers pays à s’émanciper de la tutelle coloniale en 1804. Pourquoi le pays s’est-il enfoncé dans des crises politiques à répétition, une pauvreté criante et désormais une violence sans précédent des gangs, qui constituent le quotidien de la population haïtienne? Les suites du passé colonial, les ingérences extérieures et la corruption des élites se sont mutuellement renforcés pour produire ce mélange délétère. Les opérations successives, même bien intentionnées, des Nations Unies, n’ont produit que des résultats éphémères, et parfois dramatiques, poussant le Conseil de sécurité de l’ONU à redéfinir son approche en matière de maintien de la paix, en s’éloignant des modèles traditionnels. Voici un éclairage sur cet enchaînement historique des événements.
Thomas Lennon et Quentin Moussebois, APNU Jeunes
Le Forum des Jeunes lance la sélection 2025-2026 des délégué·es ONU !
Chaque année, le Forum des Jeunes propose à des jeunes de 18 à 30 ans, de porter les voix et les revendications des jeunes belges aux niveaux local et international. Cette année, trois mandats sont ouverts: climat, jeunesse & société, et biodiversité. Mise en place de projets concrets, campagnes d’information et de sensibilisation, participation à des réunions en Belgique et à l’étranger... Durant 2 ans, les délégué·es ONU auront des mandats et missions larges et variés. En savoir plus